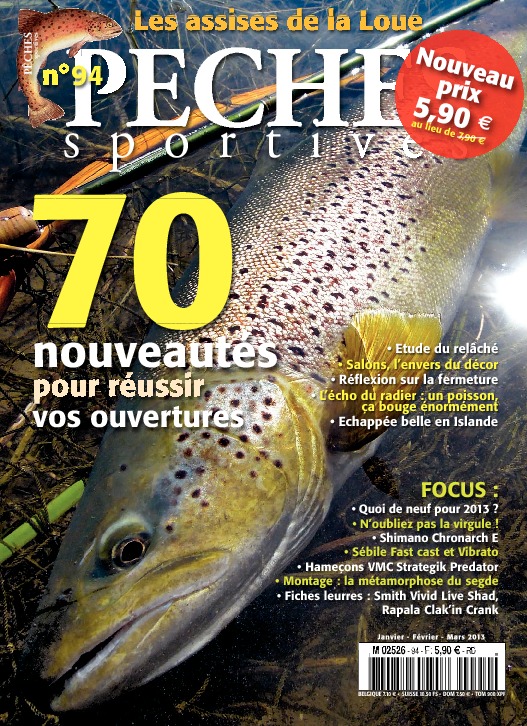Micropolluants et milieux aquatiques
Sylvain Richard aborde ici les micropolluants dérivés des métaux lourds qui se retrouvent dans les milieux aquatiques. Des informations malheureusement bien utiles dans nos cours d’eau…
Les métaux lourds
On appelle métaux lourds les éléments métalliques naturels, métaux ou métalloïdes , caractérisés par une masse volumique élevée, supérieure à 5 grammes par centimètre cube. Ils sont présents dans tous les compartiments de l’environnement, mais en général en quantités très faibles ; on dit ainsi qu’ils sont présents “en traces”. Ce sont ainsi près de quarante et un métaux qui correspondent à cette définition générale, dont notamment l’aluminium, l’arsenic, le cadmium, le chrome, le cuivre, le fer, le mercure, le plomb ou encore le zinc. L’appellation métaux lourds est cependant une appellation courante qui n’a ni fondement scientifique, ni application juridique. La classification en métaux lourds est d’ailleurs souvent discutée car certains métaux toxiques ne sont pas particulièrement “lourds” (le zinc par exemple), tandis que certains éléments toxiques ne sont pas tous des métaux (l’arsenic qui est un métalloïde*). Pour ces différentes raisons, la plupart des scientifiques préfèrent à l’appellation métaux lourds, l’appellation “éléments en traces métalliques” – ETM – ou par extension “éléments traces”. Parmi les nombreux métaux lourds susceptibles de contaminer les milieux aquatiques, trois éléments principaux sont particulièrement suivis : le mercure, le plomb et le cadmium. En effet, ces trois métaux présentent une certaine toxicité pour l’homme, entraînant notamment des lésions neurologiques plus ou moins graves (ils sont cancérigènes et modifient le fonctionnement du système nerveux, du sang et de la moelle osseuse).
Tandis que tous les autres métaux ont une utilité dans le processus biologique – certains métaux (les oligo-éléments) sont même indispensables à la vie (fer, cuivre, nickel, chrome…), les trois métaux cités sont des éléments uniquement toxiques. Par ailleurs, s’ils se transportent et changent de forme chimique, ils ne se détruisent pas et ils ont une conductivité électrique élevée qui fait qu’ils sont utilisés dans de nombreuses industries. Le plomb est issu d’un minerai, la galène. L’utilisation du plomb est directement liée à la métallurgie, avec deux pics notables. À l’Antiquité, l’utilisation métallurgique du plomb a connu son apogée sous l’empire romain, lorsqu’il était utilisé pour la production de monnaie, les canalisations, la vaisselle… A tel point que ce phénomène peut être parfaitement suivi par l’analyse des glaces polaires. La révolution industrielle a entraîné de nouvelles utilisations massives de plomb. Pendant la première moitié du XXè siècle, il était utilisé dans l’industrie, l’imprimerie, les peintures. Dans la seconde moitié, son utilisation dominante était liée aux carburants automobiles, le plomb étant ajouté à l’essence comme antidétonant (cette utilisation est aujourd’hui prohibée).
Le cadmium est un élément naturel, présent dans certains minerais (notamment le zinc) sous forme d’impuretés. Ce métal était inconnu jusqu’au XIXè siècle, jusqu’à ce que ses caractéristiques physico-chimiques soient mises en évidence et utilisées notamment dans les batteries. Il a été abondamment utilisé dans des utilisations diffuses pour protéger l’acier contre la corrosion ou comme stabilisant pour les plastiques et les pigments.
Le mercure, quant à lui, est rare dans le milieu naturel : il se trouve sous forme de traces dans les roches. Comme le plomb, il est utilisé depuis l’Antiquité et ses capacités à s’associer à d’autres métaux ont été mises à profit pour extraire l’or. Il a aussi été utilisé pour ses propriétés biologiques, y compris biocides (tannerie, médecine pour traiter la syphilis). Extrêmement volatile, il est aujourd’hui utilisé dans la production du chlore et quelques produits de consommation ou de mesures (piles, thermomètres…).
Les sels métalliques contaminent les milieux aquatiques
Les métaux sont utilisés sous forme solide en alliage, lorsqu’ils se combinent avec un autre métal, ou en sels, lorsque le métal est combiné avec certains éléments non métalliques. Sans rentrer dans les détails complexes de la formation des sels métalliques, nous pouvons simplement préciser que leur formation découle d’une attaque oxydante : le métal est oxydé en un ion positif (cation) et se combine alors avec un ion négatif (anion) pour donner un sel. Les anions les plus courants pour former un sel avec les métaux sont les chlorures (de mercure, d’aluminium), les sulfures (de plomb, d’arsenic) ou encore les oxydes (de fer, de plomb). La plupart des sels métalliques sont solubles dans l’eau et c’est sous cette forme que les métaux contaminent l’environnement. L’eau est ainsi un vecteur privilégié dans la propagation des métaux lourds, car elle va entraîner des réactions chimiques plus ou moins complexes liées à son acidité, son alcalinité, sa température, son oxygénation… Même rejetés en quantité très faible, ils sont de nature à entraîner des nuisances par la coexistence des deux phénomènes de bioaccumulation – accumulation dans certains tissus d’un organisme d’un composé toxique non métabolisé et/ou excrété – et de biomagnification – concentration des composés toxiques au fur et à mesure des absorptions dans la chaîne alimentaire, augmentant par là même leur toxicité pour les organismes. Même si aujourd’hui les principaux établissements industriels se sont dotés de dispositifs d’épuration spécifique, avec plus ou moins de réussite il est vrai, l’eau des rivières et des fleuves a longtemps été l’exutoire des effluents industriels, des eaux résiduaires ou encore des déchets liquides. Actuellement, comme le rapporte un récent rapport sénatorial, tout le monde s’accorde à reconnaître que l’industrie est responsable de la quasi-totalité des rejets de métaux lourds dans l’eau.
Les hydrocarbures et les solvants
Les produits de combustion de matières organiques ou de dérivés du pétrole, les hydrocarbures polycycliques aromatiques, sont également des substances très toxiques rencontrées dans les eaux, parfois à des concentrations importantes. Ils peuvent provenir soit de la pollution atmosphérique, car ces composés sont fréquents à l’état d’aérosol, soit de ruissellement d’origine routière ou autoroutière, soit de colorants industriels.
Ces substances sont connues pour contaminer l’atmosphère des zones densément peuplées ainsi que les cours d’eau importants qui irriguent ces zones urbaines. Leur présence en concentrations significatives n’a jamais été mise en évidence pour les cours d’eau de moyenne montagne ou de têtes de bassin référentielles. Les solvants ont, quant à eux, pour origine l’activité industrielle, notamment métallurgique.
La grande famille des pesticides
Les pesticides, utilisés dans l’agriculture et le traitement du bois, sont des substances obtenues le plus souvent par synthèse chimique, dont les propriétés toxiques permettent de lutter contre les organismes nuisibles, tout en assurant le bon développement des cultures et en préservant les rendements et la qualité des denrées alimentaires. D’un point de vue réglementaire, on distingue les pesticides utilisés principalement pour la protection des végétaux que l’on appelle produits phytopharmaceutiques ou plus communément produits phytosanitaires, des autres que l’on appelle biocides. Dès l’Antiquité, l’usage de produits pour la protection des plantes existait : Homère signalait l’action du soufre comme fumigeant, Pline l’Ancien celle de l’arsenic comme insecticide. Mais l’emploi courant de substances phytosanitaires en agriculture date du XIXe siècle et se développe avec la croissance démographique et le développement urbain. En 1939, le DDT (dichlorodiphényl- trichloro-éthane) est découvert et, à partir de là, de nombreux produits organiques de synthèse vont faire leur apparition. À partir de 1970, les problèmes de pollution dus à l’usage de produits phytosanitaires sont soulevés et, à compter de 1972, de nombreux pesticides organochlorés sont interdits, dont le DDT, l’aldrine ou la diedrine. Aujourd’hui, les substances actives utilisables en agriculture sont au nombre de 800 environ, dont environ 400 utilisées en France, et entrent dans la composition de plus de 6 000 produits. Ces produits doivent bénéficier d’une autorisation de mise sur le marché, délivrée par le ministère chargé de l’agriculture, après une procédure d’évaluation du risque pour la santé publique et l’environnement.
* Un métalloïde est un élément qui combine certaines caractéristiques du métal et d’autres caractéristiques opposées, l’absence de conductivité électrique par exemple. L’arsenic est, par exemple, un métalloïde.